29/04/2012
La Centrale
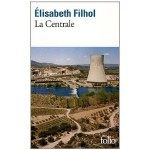 C'est un de ces romans qu'on achète pour le thème traité. Une attitude à double tranchant, parfois jackpot, le plus souvent raté. Combien de récits prétentieux et vains ont été écrit au motif seul que l'auteur avait trouvé une bonne idée, ou un bon décentrage ? Trop. Parcourir quelques lignes au hasard du mince livre (132 pages) me convainquait sans mal que l'auteur, pour son premier roman, n'avait pas commis ces péchés d'orgueil. J'achetais donc la centrale, qui traite de travailleurs précaires, d'intérimaires itinérants, en centrale nucléaire.
C'est un de ces romans qu'on achète pour le thème traité. Une attitude à double tranchant, parfois jackpot, le plus souvent raté. Combien de récits prétentieux et vains ont été écrit au motif seul que l'auteur avait trouvé une bonne idée, ou un bon décentrage ? Trop. Parcourir quelques lignes au hasard du mince livre (132 pages) me convainquait sans mal que l'auteur, pour son premier roman, n'avait pas commis ces péchés d'orgueil. J'achetais donc la centrale, qui traite de travailleurs précaires, d'intérimaires itinérants, en centrale nucléaire.
Le thème est là, dense, permanent, à la limite de l'oppression. Documenté, le livre nous plonge dans le quotidien de ceux que l'on expose aux radiations. Loin d'en faire des héros comme ceux qui se sont sacrifiés pour refroidir Fukushima, elle en fait plutôt de pauvres hères qui vendent littéralement leur peau : leur grande angoisse n'est pas d'être irradié, ils sont sans illusion là dessus, mais de l'être trop pour pouvoir continuer à bosser. Car il en va du temps passé dans les centrales comme pour les puces de téléphones portables, quand il n'y a plus de crédit, ça coupe. Ce couperet permanent au dessus des esprits de ces hommes seuls même en groupe et triste même quand ils rient donne au livre cette patine de réalité que l'on encense chez Zola dans les manuels scolaire.
Ecriture sèche comme pour ne pas perdre le lecteur dans des effets de manche, pour qu'il ne puisse pas se rattraper à des adjectifs chaleureux, des tournures un peu épaisses. Tout est à l'os. La psychologie du héros aussi, mononeurone. Préserver son corps pour pouvoir aller de centrale en centrale, de Chinon en Gironde, puis au Tricastin ou Flammanville, qu'importe le lieu pourvu qu'on ait le contrat. Il n'y a pas de femmes dans cet univers où l'on se protège de tout contact, y compris physique. L'alcool ne rend pas ivre, la nourriture ne remplit pas, l'émotion et les sentiments sont parfois effleurés, mais chez ces gens-là on ne montre pas monsieur, on ne montre pas. On fait. Sans se demander le but de tout cela. L'absurdité absolue est atteinte quand le narrateur doit payer de sa poche une formation pour obtenir un job qui lui revient de droit. S'il était employé d'EDF ou d'Areva, il y aurait droit, mais ce secteur archi dérégulé ne connaît plus le droit commun. Tout est sous-traité et en premier lieu l'humain. Cette inhumanité du travail est ici magnifiquement rendue. Jamais les personnages ne se glorifient d'apporter plus que la lumière à leurs compatriotes. Ils ne jugent pas, ne réfléchissent pas, sans doute n'en pensent-ils pas moins, mais le livre s'achève sans que l'on puisse avoir un indice de leurs positions.
Alors que la fête du travail arrive sur fond de polémiques ineptes, lire ce roman dur nous ramène à la question du travail, si secondaire dans les débats. On ne parle plus que de l'emploi, raréfié, pour mieux faire accepter à tout le monde un travail qui se dégrade, le roman d'Elisabeth Filhol est là pour nous faire réfléchir. C'est une des grandes vertus de la littérature.
Demain, nous ferons le grand écart. Du français à l'américain, d'une femme à un homme, d'un premier roman à l'ultime recueil de nouvelles d'un auteur qui compte plus de 50 récits. John Updike est mort en 2009, mais il a laissé une vaste, élégante et subtile oeuvre que l'on peut continuer à déguster sans regarder la date. C'est une belle victoire de la littérature sur les yaourts.
18:16 | Lien permanent | Commentaires (2)
27/04/2012
Propaganda
 Entre deux hoquets vomitifs de cette campagne qui ne veut pas finir plus vite, malgré un ras le bol évident de 90% des électeurs, il faut bien s'évader par les livres. Thérésa l'après midi de Juan Marsé m'avait tellement emballé que j'avais bissé un peu vite avec l'amant bilingue du même auteur catalan et je ne l'ai pas fini tant c'était pénible. Je me mis donc en quête d'essais dans une autre librairie de quartier, le livre Ecarlate (excellente librairie). Là, au détour d'une étagère surchargée, je trouvais un livre dont j'ai vanté les mérites 100 fois à mes étudiants sans jamais l'avoir lu : Propaganda, d'Edward Bernays.
Entre deux hoquets vomitifs de cette campagne qui ne veut pas finir plus vite, malgré un ras le bol évident de 90% des électeurs, il faut bien s'évader par les livres. Thérésa l'après midi de Juan Marsé m'avait tellement emballé que j'avais bissé un peu vite avec l'amant bilingue du même auteur catalan et je ne l'ai pas fini tant c'était pénible. Je me mis donc en quête d'essais dans une autre librairie de quartier, le livre Ecarlate (excellente librairie). Là, au détour d'une étagère surchargée, je trouvais un livre dont j'ai vanté les mérites 100 fois à mes étudiants sans jamais l'avoir lu : Propaganda, d'Edward Bernays.
Je ne fais que suivre les sages préceptes de Pierre Bayard dans Comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Il suffit de méta éléments pour parler d'une oeuvre. Savoir que Bernays est le neveu du Freud et que Stiegler en fait le premier des ennemis de classe dans l'abus des techniques de marketing suffit à parler de ce livre. Après l'avoir lu, vraiment, de nouvelles perspective s'ouvrent. Et c'est d'autant plus étonnant que Bernays ne fait que parler de choses que je suis censé observer au quotidien, avec acuité: les relations publiques, la propagande clandestine, la persuasion invisible...
Daté de 1928, ce court texte (140 pages) réédité en 2007 par Zones propose une vision glaçante du monde, déjà rencontrée chez de nombreux auteurs à commencer par leur Dieu et prophète à la fois à tous: Jeremy Bentham. Le père de l'utilitarisme n'est jamais cité par Bernays et pourtant il est derrière chaque pensée. La propagande est sous-tendue par l'idée que tout acte, toute pensée, tout sentiment peut être réduit à sa seule dimension d'efficacité. D'accord, le don n'est jamais gratuit, mais rarement le cynisme n'aura été poussé aussi loin que dans cet opuscule. A lire Bernays, si Bernard Tapie est coupable de quelque chose, c'est de philanthropie. Bernays était un homme de l'ombre qui conseillait des gouvernements ou des lobbys (banques, producteurs de patate, textile...) ce qui est infiniment plus dangereux que ceux qui assument la promotion de seules marques. Bernays retrace un grand nombre d'exemples édifiants montrant comment avec un peu de bonne mauvaise volonté et de moyens, on peut faire fumer les femmes, vendre n'importe quel candidat à la présidentielle ou porter du velours. Ce qui est troublant, le livre fermé, c'est justement cela : il n'y a pas de différence chez Bernays. Sentiment, marque, produit, armes de guerre, tout est marketable. Pire, qui ne rentre pas dans cette logique est un hérétique. Ainsi, sur la politique, on trouve cela : "la politique fut la première grande entreprise américaine. Aussi est-il assez piquant de constater qu'alors que l'entreprise privée a parfaitement assimilé les enseignements de la politique, la politique elle-même n'a pas appris grand chose des méthodes commerciales de diffusion de masse des idées et des produits". 84 ans plus tard, force est de constater que les politiques ont lu Bernays et que c'est bien triste.
Reste l'éternelle question avec les classiques; leur actualité. Comment un ouvrage écrit en 1928 et fondé sur les outils permettant aux décideurs de parler au plus grand nombre de personnes possibles peut-il être toujours valable quand en 1928 la télévision et surtout Internet n'existait pas, n'étaient même pas dans les limbes ? Mon pari est que si Bernays vivait encore il serait sans doute en train de former Patrick Buisson et Karl Rove qui ne lui arrivent pas à la cheville. Pas tout à fait visionnaire (l'homme prévoyait le déclin de la radio) Bernays maîtrisait si bien les outils dont il disposait que je ne préfère pas penser à ce qu'il aurait fait de Twitter et Facebook. Je dois ce pronostic à une phrase anodine, vers la fin de l'ouvrage: "d'aucuns rétorqueront bien sûr que la propagande finira par causer sa propre perte, dans la mesure où le grand public en comprend de mieux en mieux les mécanismes. Je ne suis pas de cet avis. La seule propagande qui perdra en crédit au fur et à mesure que le monde deviendra plus subtil et plus intelligent est celle qui est fallacieuse ou foncièrement antisociale". En cela, la prescience de Bernays est remarquable, il sait que les dominants le demeurent car ils ne se reposent pas sur leurs lauriers et cherchent toujours des moyens plus sibyllin de persuader. Egalement, malheureusement, et les résultats du 22 avril vont en ce sens, en jouant contre l'éducation, car un peuple véritablement éclairé ne pourrait produire ses résultats.
Demain, nous retournerons à Ménilmontant pour refaire le monde autour de quelques bouteilles, de quelques cartes à jouer et qui sait si tout cela ne finira pas à nouveau avec des oreilles de lapin...
16:59 | Lien permanent | Commentaires (3)
24/04/2012
Carte postale de Madrid
 Sensation étrange de partir, j'allais dire de déserter, la veille d'un scrutin aussi important. Ca ne m'est jamais arrivé, d'ailleurs. Une obligation professionnelle de l'amoureuse servait de prétexte et zou nous voilà à Madrid la veille du premier tour de la présidentielle dans un pays qui s'en tamponne comme les poules des oscillations de la mode. Bien sûr, ma procuration et celle de l'amoureuse ont été laissé à des personnes de confiance, mais tout de même. Etrange.
Sensation étrange de partir, j'allais dire de déserter, la veille d'un scrutin aussi important. Ca ne m'est jamais arrivé, d'ailleurs. Une obligation professionnelle de l'amoureuse servait de prétexte et zou nous voilà à Madrid la veille du premier tour de la présidentielle dans un pays qui s'en tamponne comme les poules des oscillations de la mode. Bien sûr, ma procuration et celle de l'amoureuse ont été laissé à des personnes de confiance, mais tout de même. Etrange.
La première surprise à Madrid, c'est la différence qui vous saute aux yeux entre le discours anxiogène et apocalyptique des marchés, repris la bouche en coeur par tous les médias avec une telle capacité amplificatrice que l'on en vient presque à résumer l'Espagne à un seul mot : crise. Je sais bien que la réalité est plus complexe que ce que je vois, les phénomènes de gentrification font que les plus fortunés se retrouvent dans les grandes villes d'où les plus modestes s'éloignent inexorablement. Mais quand même, quelle liesse et quelle joie dans toutes les rues, tout le temps, des terrasses de café pleines, des bars à tapas bondés... Par ailleurs, il y a infiniment moins de SDF dans les rues qu'à Paris, ni dans les rues, ni dans le métro, ça en devient suspect pour un pays à 20% de chômage, 45% pour les jeunes.
Ceci mène à penser à une autre victoire du libéralisme : la consommation. Crise il y a en Espagne sans doute, mais pas au point d'avoir retourné les espagnols de leurs aspirations à consommer. J'avais entendu un jour un chroniqueur mondain (je crois que c'est Ariel Wizman) avoir une fulgurance et s'exclamer "l'injustice aujourd'hui c'est que tout le monde peut avoir au superflu quand le nécéssaire et le vital deviennent hors de portée", celle là était fort bien sentie. Dans les bars, on voit des gens lookés, avec leurs paquets du corte ingles et leur maillot du real de Madrid à 70 euros, envoyant des messages à leurs amis par Iphone pour voir dans quelle boîte de nuit aller. Mais, le soir, quand ils vont se coucher, c'est souvent chez leurs propres parents à un âge où cela devient suspect. Et quand leurs dents les font souffrir d'avoir abusé des churros et des saloperies de vodka red bull, ils rechignent à aller voir un dentiste de peur de ne pouvoir payer la bien nommée douloureuse... Tant que ce ressort consumériste sera là, puissant, écrasant, surplombant, alors l'alternance démocratique aura lieu entre vrais conservateurs et socialistes libéraux. Une française vivant à Madrid depuis un an nous confirme l'impression : la pauvreté est moins visible qu'en France et il y a plus de solidarité familiale. Pour autant, on sent malgré tout que cela pourrait imploser dans quelques années, les enfants de 30 ans pouvant difficilement faire des enfants à leur tour tout en vivant chez leurs parents. Idem pour tout ceux qui ont été mis au chômage depuis 2008, (nombre qui a presque triplé) : ils ne pourront pas éternellement reproduire des formations, des erasmus et autres. C'est plutôt en 2015 que l'Espagne pourrait commencer à nous inquiéter, ce d'autant qu'avec des indemnités chômages très faibles, l'implosion pourrait vraiment être violente. Passons pour l'heure.
A Madrid, il n'y a pas qu'une cohorte de bars, il y a des musées aussi. Pas n'importe lesquels. En premier lieu, nous n'y tenions plus, nous nous ruâmes au Prado. Surprise, les chefs d'oeuvre que l'on y trouve sont des chefs d'oeuvre. Me revient en mémoire ma première rencontre avec la Joconde et un sentiment de profonde déception. Alors, avant d'aller voir les Ménines de Velasquez, j'en menais pas large. Mais quelle merveille ! Quelle merveille d'humanité ou d'inhumanité (chez l'infante ou la naine), d'intelligence, de jeux de lumière, faire rentrer autant de talent en 3x3 mètres. On ressort et c'est un festival, triptyques de Bosch, Caravage, Goya et une annonciation de Fra Angelico à vous faire douter de l'existence de l'athéïsme. Exit le Prado, ne pas se presser, Thyssen attendra le lendemain. Thyssen, quelle collection ! Des Juan Gris, Leger, Kandinisky. Un léger sentiment de trop plein en abordant 10 Sisley après une interminable salle Renaissance, Tiepolo, Tintoret et Ribera... Comme après un bon dîner avec trop de mélanges, on en sort ballonné. Pour finir, le musée de la Reine Sofia. On y trouve notamment une oeuvre qui est bien plus qu'une oeuvre: Guernica. En ce lendemain de 6,4 millions de vote pour le Pen, l'oeuvre avait une résonance particulière, la noirceur du tableau, le regard désespéré des cheveux et des femmes. Heureusement pour moi, deux salles pleines de Miro et ces couleurs chaudes me redonnaient du baume au coeur.
Les musées fermant à 19h, il faut bien aller dans les bars. Coup de bol, nous arrivâmes un soir de classico. Ce n'est plus du football, un Barça/Real capital pour l'attribution du titre de champion. C'est de la religion urbaine. Pardon pour les superlatifs, mais avec l'affluence devant tous les bars, c'est bien quelques centaines, voir quelques miliers de spectateurs citadins que nous croisons avant de trouver prophétiquement deux places de libres dans une taverne pour regarder la fin du spectacle. Nous verrons deux des trois derniers but du match, un pour chaque équipe. Fait étrange, chaque but fut accompagné de la même énorme escouade de décibels. La foule applaudissait le football. Impensable en France où la partialité s'érige en juge de paix.
Dans les bars on boit, pour presque rien des verres de vino tinto et on mange. Une amie nous glissait sous le sceau de la confidence (son nom ne sera pas révélé) qu'elle avait pris 8 kilos en 8 mois. Comme je la comprends. Chorizos, croquette au fromage, au jambon, risotto, croquette de veau, légumes frits. Chez ces cochons tout est bon ! Rien n'est vert en revanche, mon royaume pour une salade en rentrant en France (ou peut être un tartare salade/frites...) ! Et puis, en face du musée de la Reine Sofia, les madrilènes ont eu la bonne idée de mettre un Burger King, celui-là même que nous voulons tant à Paris: ha qui n'a pas mangé seul ses double bacon cheese burger à un carrefour pétardant de moteurs ne connaît goutte à la poésie urbaine...
S'il n'y avait eu ces résultats électoraux qui salissaient le goût des tapas dominicaux et laissaient sur la langue un sentiment âpre, ce week-end madrilène confinait à la perfection. De retour à Paris, nous sommes la Ste Fidèle, un signe pour le Fidèle Castor ?
Demain, nous nous replongerons dans les médias hexagonaux pour voir comment ils retranscrivent les bons mots de notre candidat président qui a défaite annoncée amère...
07:14 | Lien permanent | Commentaires (2)



