12/03/2013
La politique de la baudruche
 Plus j'avançais dans ma lecture, moins j'en revenais. Un livre bâclé, écrit dans un style de lycéen avec une conclusion de première partie qui osait cette aberration rhétorique : "il nous faudra donc voir quels sont les points négatifs et les points positifs de l'urgence". Ce genre d'inepties jalonne les courts chapitres, truffés de sondages et d'enquêtes d'opinions, les seules données scientifiques dont dispose l'auteur. La ponctuation aussi est enfantine, car débordant de "!" et de "?" primaires, et de marques d'autosatisfaction telles que, "et si je m'étais trompé ?". A peine croyable, mais c'est ainsi que débute l'introduction qui s'achève, je vous le donne Emile par... "alors je persiste et je signe ! ". T'as raison mon cochon, aide toi le ciel t'aidera, c'est mieux de s'apprécier soi même en attendant que les autres ces ingrats, te tressent des louanges (même s'ils le firent).
Plus j'avançais dans ma lecture, moins j'en revenais. Un livre bâclé, écrit dans un style de lycéen avec une conclusion de première partie qui osait cette aberration rhétorique : "il nous faudra donc voir quels sont les points négatifs et les points positifs de l'urgence". Ce genre d'inepties jalonne les courts chapitres, truffés de sondages et d'enquêtes d'opinions, les seules données scientifiques dont dispose l'auteur. La ponctuation aussi est enfantine, car débordant de "!" et de "?" primaires, et de marques d'autosatisfaction telles que, "et si je m'étais trompé ?". A peine croyable, mais c'est ainsi que débute l'introduction qui s'achève, je vous le donne Emile par... "alors je persiste et je signe ! ". T'as raison mon cochon, aide toi le ciel t'aidera, c'est mieux de s'apprécier soi même en attendant que les autres ces ingrats, te tressent des louanges (même s'ils le firent).
Sinon, comme tous les élèves cossards, mais dotés d'un solide vernis, il glisse quelques citations des maîtres sur la question sur laquelle il disserte (Régis Debray et Hartmut Rosa, pas de bol pour lui, ce sont aussi les miens et j'ai lu les livres en question) pour étayer son propos. Mais il ne fait que paraphraser les maîtres sans rien avancer. Tout cela si bien qu'à la fin du livre, il est impossible de mettre la moyenne à cette très faible copie. Il faut malheureusement proposer le redoublement de l'élève et l'inciter à se réorienter. Problème, l'ensemble des médias lui avaient déjà décerné les laudes et couronnes réservées aux premiers de la classe. Que tout le monde ait pu dire du bien de "La Dictature de l'urgence" de Gilles Finchelstein peut laisser songeur. Si l'on décortique la chose trois minutes, pas de quoi sombrer dans des abîmes de perplexité non plus : il s'agit d'un magnifique exemple de politique de la baudruche. Explication.
L'auteur. Finchelstein n'est pas un universitaire, un chercheur ou un journaliste d'investigation, mais un intellectuel influent. Pour ne pas se perdre dans des approximations, on peut lire sa fiche Wikipédia qu'il a manifestement corrigé lui-même, soucieux de son image numérique, afin de continuer à récuser l'évidence de son inclination sociale-libérale. On peut voir qu'il mélange les genres : à la tête d'un think tank, directeur des études pour une agence de com', plume de ministre (DSK puis Mosco) il passe sa vie à grenouiller. Or, à quasi 50 ans, il n'a rien publié. Ca ne fait guère sérieux, il sort donc un premier livre (feuilleté et jeté sur la pile) avec l'ineffable Matthieu Pigasse sur le monde d'après la crise. Les médias choisissent le banquier pour parler de l'après crise et Finchelstein reste dans l'ombre. Il fulmine et bâcle dont le présent livre pour avoir droit aux honneurs des gazettes et être enfin reconnu comme un intellectuel de premier plan. Les médias sont trop heureux d'avoir enfin un prétexte pour inviter celui dont le nom filtrait dans tous les articles sur DSK et renouveler le cheptel de "penseurs de gauche", il gagne le droit de faire le tour complet des popotes pour parler d'un livre facile à pitcher, disserter, chroniquer sans l'avoir lu puisque le principe est "il faut redonner du temps au temps" avec des exemples piochés chez Mc do, Zara ou Apple pour expliquer l'accélération de l'histoire... Et voilà comment le caniveau est porté au pinacle.
Pas besoin d'être grand clerc pour voir que cet opus a été rédigé comme pour beaucoup d'éditocrates : dans les taxis, les halls d'aéroports, dans des halls de Sofitel en attendant à chaque fois, l'arrivée d'huiles diverses. Ironie de l'histoire, Finchelstein a sans doute consacré infiniment plus de temps à assurer la promotion de son ouvrage qu'à l'écrire. Au final, on ne peut que suggérer à l'auteur d'appliquer ce qu'il prône pour le reste du monde : sortir de la dictature de l'urgence de sa propre vie et prendre le temps de faire un livre qui fasse sens...
09:27 | Lien permanent | Commentaires (0)
11/03/2013
Carte postale de Budapest
 Le ciel de papier mâché n'aurait pas su nous gâcher notre visite. Pas plus que cette langue à laquelle nous n'entravions que pouic. Bien décidés aussi à oublier ce que nous savions de la politique de l'actuelle gouvernement hongrois, nous partîmes à deux et sans attendre de renfort, parcourûmes les trottoirs souvent déglingué pour arriver dans notre premier bon port, ce qui est un comble, lorsqu'on songe qu'il s'agit de la grande synagogue (ça va, pardon). C'est très étonnant de voir la plus belle synagogue d'Europe et un grand ghetto très dynamique, truffé de bars immenses et étonnants (j'y ai croisé Batman et deux Wonder Women) dans un pays où les actes, propos et autres saloperies antisémites fleurissent à nouveau depuis quelques années.
Le ciel de papier mâché n'aurait pas su nous gâcher notre visite. Pas plus que cette langue à laquelle nous n'entravions que pouic. Bien décidés aussi à oublier ce que nous savions de la politique de l'actuelle gouvernement hongrois, nous partîmes à deux et sans attendre de renfort, parcourûmes les trottoirs souvent déglingué pour arriver dans notre premier bon port, ce qui est un comble, lorsqu'on songe qu'il s'agit de la grande synagogue (ça va, pardon). C'est très étonnant de voir la plus belle synagogue d'Europe et un grand ghetto très dynamique, truffé de bars immenses et étonnants (j'y ai croisé Batman et deux Wonder Women) dans un pays où les actes, propos et autres saloperies antisémites fleurissent à nouveau depuis quelques années.
Nous nous en ouvrîmes auprès de notre ami de l'apéro, universitaire de son état et plus précaire que les précaires chez nous. Fin lettré, il nous apprit que l'Etat procédait à des coupes sombres dans les budgets de recherche de l'ordre de 35%. La grande bibliothèque, qui n'est pas encore numérisé, vient ainsi de supprimer 20% de ses effectifs. Les protections sociales du modèle communiste ont chuté depuis longtemps, mais de plus la chute du pouvoir d'achat n'a pas été endigué par des tarifs autochtones/touristes comme à St Pétersbourg ou les russes payent une piecette à l'entrée de l'Ermitage quand les touristes paient le fonctionnement avec un tarif standard. Ainsi, notre ami nous expliqua que les bains que nous convoitions avec enthousiasme (comme en médaillon où l'on peut se baigner en extérieur même lorsqu'il fait frais) avaient vu leurs tarifs augmenter dans des proportions si fortes que les hongrois ne peuvent plus y aller. Je peinais à y croire mais le lendemain, alors que nous nous rendîmes dans les très chics bains de l'hôtel Gellert, force était de tristement constater qu'il n'avait pas menti : ça parlait russe, français, anglais et italient, mais rien de cette langue si étrange qu'est le hongrois.
Idem, malheureusement, dans la Galerie Nationale, ce musée immense sis au sommet d'une colline, promontoire idéal pour contempler les deux rives de la ville. Des merveilles médiévales et renaissantes, la découverte pour nous d'un très grand peintre hongrois, Munkacsy, toutes ces observations se firent en comité restreint, sans autochtones. Le lendemain, direction le Musée des Beaux Arts qui, merveille des merveille, proposait une très vaste rétrospective Daumier. Un cas similaire à Paris aurait entraîné une frustration forte : celle d'être serrés devant des oeuvres de petite taille et de ne pouvoir admirer à loisir toutes les finesses. Pareil mésaventure m'est échue lors d'une expo sur les eaux fortes de Rembrandt et ça m'avait gâché le goût. Là, rien, peau de nib. Une immense galerie et peut être trois personnes en plus de nous. Nous remontions dans la galerie principale où à peine plus de badauds miraient les cinq ou six Le Greco.
A l'inverse, nous nous sommes rendus à l'Opera voir Don Giovanni et c'était blindé blindé. En achetant mes tickets en ligne, j'avais halluciné mais les places coûtaient 2 euros. J'avais payé une pinte exactement le même prix la verre. Les bars sont plutôt remplis aussi, où tout le monde assèche à grands renforts de bières les sècheresses de la palinka (leur digestif local). Les restos aussi, qui révèlent souvent de bonnes surprises même s'ils s'entêtent à noyer leurs meilleures viandes sous une piscine de sauce.
Au-delà des escapades classiques, Budapest vaut pour son architecture. Les merveilles classiques sont restaurées, mais les immeubles déglingués pullulent, les travaux sont partout avec un respect relatif des normes sécurité sur les chantiers (on a failli se ramasser du platre tombant du 6ème étage). Il faut fuir les grandes avenues soviétisantes et se perdre dans les rues qui abritent parfois de belles surprises. La plus belle des nôtres fut de tomber nez à nez avec le cinéma Pouchkine. La facade art déco nous intrigua donc nous rentrions, une minute après commençait "Amour" de Haneke. Le voir sous titrer en hongrois est un luxe estimable. Nous emporterons vers Paris ces quelques instants d'une rare finesse et quelques sachets de paprika comme madeleines du voyage. D'autant plus pratique qu'ils en mettent dans tout...
Demain, nous nous empresserons d'hâter le plus lentemnet possible notre retour à un rythme parisien.
08:07 | Lien permanent | Commentaires (0)
07/03/2013
Karoo il y a de l'art, il y a de la vie.
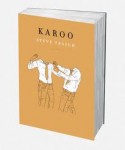 Ha les jaquettes des livres ! "Etonnant, fascinant, noir à souhait, grinçant". J'ai flanché, pour une fois, et happé par les dithyrambes publicitaires, je feuilletais ce livre sagement niché parmi les milliers abrités par la librairie. Bien m'en pris, il est remarquable à tous points de vue.
Ha les jaquettes des livres ! "Etonnant, fascinant, noir à souhait, grinçant". J'ai flanché, pour une fois, et happé par les dithyrambes publicitaires, je feuilletais ce livre sagement niché parmi les milliers abrités par la librairie. Bien m'en pris, il est remarquable à tous points de vue.
L'objet d'abord, les éditions Toussaint Louverture publient fort peu. Mais l'artisanat éditorial se savoure de la belle couverture illustrée au choix du papier et à la mise en page aérée et la police très agréable (ceci n'est pas un communiqué de presse contre le livre numérique). Au-delà de l'objet cet ample roman -600 pages- s'avale avec délice. Des la scène d'exposition, on est ailleurs. Dans le New York que connaît Tom Wolfe, mais revisité par les vices de Bukowski et filmé par l'oeil pétillant de Billy Wilder. La première scène campe fort bien cette débauche d'en haut. Un grand appartement bourgeois, celui des Mc Nab, qui invitent une fois l'an le tout Manhattan pour une soirée rythmée par les oeuvres de Beethoven. A la 9ème tout le monde est dehors (ils ont donc dû arriver très très tôt). Là, on découvre le narrateur, Saul Karoo, esthète délabré qui vit un drame rare : il ne peut plus être ivre.
Pas par obligation médicale, ni par dégoût profond, mais par fatalité. Comme dans une tragédie grecque, il a beau se noircir le museau avec tous les spiritueux et alcools divers qui lui passent sous les lèvres, impossible d'être ne serait-ce que pompette. Or, quand tout votre légende de poivrot céleste vous précède, impensable d'être du jour au lendemain sobre comme un chameau. On vous appellerait fou. Alors, il joue la comédie et titube ou chancelle par habitude. Il encaisse parfois les reproches de ceux qui lui disent qu'on ne peut lui parler car il n'est qu'un déchet jamais détrempé et il fulmine de ne pouvoir montrer sa bonne foi (à défaut de son bon foie). D'emblée, on se prend d'affection pour cet ourson entouré de parasites mondains. A part la boisson, Saul se débat avec son ex femme qui le méprise et leur fils adopté qui voudrait désespérément parler à son père. Mais Saul fuit, va vers d'autres conquêtes et se noie dans l'infini des nuits embrumés. Il y croise des playmates, des wanabees, mais aussi des producteurs qui le portent aux nues. Car contrairement à la figure du anti héros loser sur toute la ligne, Saul a de l'or dans les mains : il réécrit des scénarii minables et en fait des chefs d'oeuvre. Lucide sur lui même, il sait ne pas avoir le talent de Flaubert, donc il se contente de gagner des millions (ce sont les passages qui m'ont rendu le plus jaloux). La suite serait délectable malheureusement je ne puis la dire et c'est regrettable mais ça vous fera rire un peu si vous partez avec ce charmant gorille à L.A. puis en Espagne pour une Odyssée de la soif sans fin.
Un héros magnifique, des personnages secondaires plein et enlevés, du style et des formules qui claquent comme une cravache, Monsieur Toussaint Louverture, je suivrai désormais votre production avec un intérêt mâtiné d'impatience.
08:25 | Lien permanent | Commentaires (2)



